
Elle voudrait comprendre ce qui est arrivé à son garçon tout en sachant que largement sa douleur est irrecevable. D’elle et de son fils, elle tient cependant à tout dire, à commencer par la césarienne qu’elle a subie lors de la naissance du gamin. Ainsi, chose horrible, le fils est mort comme il est né : dans le sang. Elle récapitule également la disparition du père, les crises de larmes de l’enfance et les crises d’acné de l’adolescence. Mais elle insiste : avec de faibles ressources, elle n’a pas cessé d’être une mère aimante. Elle aurait dû manger ce fils alors qu’il était bébé, se dit-elle. Mais elle ne l’a pas fait : « Je l’ai laissé me manger, moi. Étonnant comme il était gourmand. Il l’est toujours resté. Avide, impulsif. Au point d’en devenir crédule. Chaque année une nouvelle tocade, chaque printemps un nouveau hobby. » (p. 22)
Le monologue de la “mère damnée” va beaucoup tourner autour du besoin qu’elle prête à son garçon d’obtenir la reconnaissance dont tout être a besoin pour exister. Mais que peut faire un jeune qui a grandi au temps d’Internet et des réseaux sociaux pour trouver sa place, se faire une place ? Ici surgit l’image d’Érostrate qui fascinait déjà le Sartre du Mur. Soit ce héros malheureux de l’Antiquité qui ne pouvait supporter la réalisation du temple d’Éphèse donné pour l’une des merveilles du monde. Il choisit donc d’incendier l’édifice pour égaler à sa façon l’architecte. Et il y parvint fort bien puisque l’on se souvient de lui alors que le nom de l’architecte s’est perdu dans la nuit des temps. La célébrité par le crime donc.
C’est peut-être ce qu’a recherché à tout prix le jeune djihadiste qui n’a même pas été accepté par ceux en qui il voyait ses compagnons de révolte et de guerre. Il a donc dû rentrer en Occident et “tirer son plan” (comme on dit en Belgique), affreusement seul. C’est-à-dire massacrer aveuglément, y compris se massacrer lui-même. En quête, oui, de renommée ou, plus simplement de reconnaissance — alors pourtant qu’il n’a jamais cessé d’être aimé de sa mère et qu’il a obtenu un bac technologique. Tout cela aussi plat et aussi triste qu’un champ labouré en Flandre.
Il y a quelque chose de brechtien dans la pièce de Lanoye, une pièce qui se lit fort bien. On en retiendra en particulier la rare franchise du propos et du ton, cette franchise violente qui réussit à faire exister, le temps d’un acte, un petit univers. C’est que la “mère damnée” nous livre les choses avec une volonté implacable alors qu’elle ne les comprend pas.
Tom Lanoye, Gaz. Plaidoyer d’une mère damnée, traduit du néerlandais (Belgique) par Alain van Crugten, Paris, Éditions de la Différence, “Littérature étrangère”, 2016, 10 € (en librairies le 17 mars 2016)
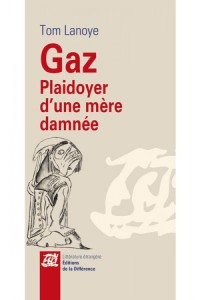
http://diacritik.com/2016/03/10/tom-lanoye-et-la-mere-du-djihadiste/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire